En complément à mon blogue publié récemment sur Littéranaute, je vous invite à lire des extraits tirés du livre de Louis Hamelin. Une histoire, un triller -devrais-je dire- à vous couper le souffle; des dialogues qui sonnent vrais; des personnages crédibles; une écriture vive et poétique. Un bonheur de lecture! Quoi de mieux pour commencer l'année 2011...
Extraits. La constellation du lynx- Louis Hamelin, Éditions du Boréal
En exergue
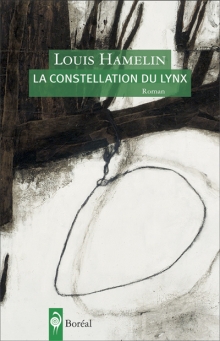 Pour eux aussi l’histoire n’était que contes pareils à
ceux qu’on a trop entendus.
Pour eux aussi l’histoire n’était que contes pareils à
ceux qu’on a trop entendus.
Joyce, Ulysse
Des agents infiltrent sans cesse le camp adverse et
le discréditent par excès de zèle; plus exactement,
les agents savent rarement pour quel camp ils travaillent.
Burroughs, Lettres
Les personnages
Les terroristes
Cellule Rébellion
Lancelot
Corbeau
Justin Francoeur
Élise Francoeur
François Langlais, alias Pierre Chevrier
Nick Mansell
Cellule Chevalier
Jean-Paul Lafleur
René Lafleur
Richard Godefroid
Benoit Desrosiers
La délégation étrangère
Francis Braffort (Paris)
Luc Goupil (Londres)
Raymond Brossard, alias Zadig } (Alger)
Daniel Prince, alias Madwar
Les littéraires
Chevalier Branlequeue, éditeur, poète, prof de littérature
Samuel Nihilo, tâcheron de la plume
Marie-Québec Brisebois, femme de théâtre
Frédéric Falardeau, chercheur
Et les autres
Général Jean-B. Bédard, chef militaire
Marie-France Bellechasse, étudiante
Bobby, agent de la CATS (Combined Anti-Terrorist Squad)
Raoul Bonnard, artiste de variétés
Maître Mario Brien, avocat des terroristes
Jacques «Coco» Cardinal, militant indépendantiste
Madame Corps, ex-femme de Coco
Marcel Duquet, militant indépendantiste
Maître Grosleau, procureur de la Couronne
Dick Kimball, Américain tranquille
Colonel Robert Lapierre, conseiller politique, éminence grise, etc.
Paul Lavoie, otage
Claude Leclerc, capitaine de police
Jean-Claude Marcel, député d’arrière-ban, ami de Paul Lavoie
Miles «Machine Gun» Martinek, sergent-détective de l’escouade
de sécurité (Sûreté du Québec)
Gilbert Massicotte, lieutenant-détective à la CATS
Rénald Massicotte, livreur de poulet chez Baby Barbecue
Bernard Saint-Laurent, sympathisant du FLQ
Giuseppe Scarpino Luigi Temperio } hommes d’affaires
John Travers, otage
Albert Vézina, premier ministre du Québec
La chronologie
[] 5 octobre 1970: Enlèvement du délégué commercial de Grande-Bretagne, John Travers, par le Front de libération du Québec.
[] 10 octobre: Enlèvement du numéro deux du gouvernement québécois.
[] 15 octobre: La Force mobile de l’armée canadienne intervient au Québec.
[] 16 octobre: Proclamation de la Loi sur les mesures de guerre par le gouvernement central du Canada; suspension des libertés civiles; près de 500 citoyens détenus sans mandat…
[] 17 octobre: Le corps du numéro deux est retrouvé dans le coffre d’une voiture.
La table des matières
Chapitre 1: Une histoire de poulets...... 15
Chapitre 2: La constellation du Lynx.. 167
Chapitre 3: Zopilote........................... 365
Note de l’auteur................................ 593
Les extraits
L'Avenir (Québec), été 1975
Je m'appelle Marcel Duquet et je vais mourir dans environ cinq minutes. Le ciel est bleu, le soleil brille, les corneilles ressemblent à des voilettes de bonnes sœurs qui partent au vent et j'aime bien le grondement du tracteur, la manière dont il me remplit les oreilles pendant qu'un autre rang de foin se couche sous la faux. J'ai quarante-deux ans, un rond chauve au sommet du crâne et il fait si chaud que j'ai l'impression d'être un de ces prisonniers que les Indiens scalpaient et pendaient par les pieds au-dessus d'un lit de braises jusqu'à ce que leur cerveau se mette à bouillir. Le foulard noué autour de ma tonsure est d'un rouge plus vif que la peinture du Massey Ferguson, il doit faire une tache bien visible contre le vert de l'érablière et le bleu du ciel pendant que je me revire au bout du champ.
Maintenant que je fauche en descendant, je l'aperçois tout d'un coup qui marche au milieu des foins coupés. Le gros Coco. L'impression que mon cœur juste là s'arrête de battre. Puis, ça repart: pensées, la salive dans ma bouche, une famille de corneilles. D'une certaine manière, je sais déjà ce qu'il me veut. Je regarde autour de moi, rien que le champ délimité par le vieux perchis de cèdre, le bois de trembles et de sapins, puis l'érablière, plus haut la couche épaisse de bleu, la rivière invisible, au bout de la terre. Devant, au gros soleil, il y a Coco Cardinal qui s'avance dans le champ, tout rouge, la face en sueur, trop gros, penché, les mains qui battent l'air, le souffle court. J'ai mis pied à terre et laissé tourner le moteur du tracteur. Je marche vers Cardinal, qui s'est arrêté un peu plus loin et qui grimace à cause du soleil, de la trop forte lumière, qui m'attend. Le temps de franchir la distance qui me sépare de lui, je torche les rigoles de sueur brûlante sur mes paupières et mon front. Je laisse un espace de trois pas entre nous. J'avale ma salive. J'arrive à sourire.
-= Eh, Coco. Ça fait longtemps...
Il hausse les épaules. Il sue comme un cochon, tout dépoitraillé dans sa chemise d'été trempée aux aisselles. Il pompe l'huile, les poumons lui sortent par le nez. Ses yeux rouges comme des fourmis veulent lui décoller de la tête. Juste avant qu'il ouvre la bouche, un poing noir se referme sur mes tripes.
-= Pis, mon Marcel? T'étais pas bien en prison? J'espère qu'ils ont pris un manche à balai pour t'enculer...
Il se trouve drôle. Il ricane, Coco. Je jette un nouveau coup d'œil aux alentours, sur le beau foin debout, c'est plus fort que moi. Personne en vue. Mon cœur cogne dur, mais je l'entends à peine. J'ai de la misère à bouger. Mais comme je l'ai dit, j'arrive à sourire.
-= Passé à travers, comme tu vois...
Il renifle un coup, deux coups, il n'arrête pas, des tics plein la figure. Encore cette saloperie. Pendant qu'il renifle, on dirait qu'il réfléchit. Je me demande si je n'aurais pas dû en profiter. Prendre les devants, lui sauter à la gorge, qu'on en finisse, d'une manière ou d'une autre. J'ai laissé passer ma chance.
-= J'en connais qui disent que tu parles trop. Que depuis que t'es sorti, t'es devenu une vraie pie...
J'essaie d'avaler, rien à faire. Il crache par terre.
-= Une maudite pie!
Il n'a pas sa voix normale. Je fais un geste comme pour protester, mais mon bras a l'air de peser une tonne. Le sien, c'est le contraire: il bouge avec la rapidité d'un cobra et il y a main- tenant un revolver accroché au bout. Je sens un rond de métal froid se poser sur mon front, qui suce tout ce que j'ai à l'intérieur. Mon cerveau qui fond comme un glaçon, rond, front. Rien d'autre.
-= L'autre chose, mon chien, c'est que tu m'as volé ma femme...
J'essaie de dire non, mais je réussis seulement à secouer la tête, mais pas trop, à cause du froid du métal sur ma peau, toujours là, et qui fait que tout ce qui m'arrive se passe maintenant très loin de moi, de ma tête qui retombe, qui part tout doucement vers l'avant et le rond noir qui me rentre dedans plus dur et profond, au milieu du front, dans ma peau labourée par le soleil. L'excitation de sa grosse voix sale.
-= À genoux, Duquet! Envoye, à genoux devant moi! Et je te le dirai pas deux fois...
Je me laisse tomber et c'est comme un soulagement, je commence à dire pardon, je veux le dire, les yeux levés, à travers cette vallée de larmes, vers le canon qui creuse son trou dans le silence, ce point aveugle du champ, noir de lumière oubli, de soleil terre chaude. Les foins debout et ceux couchés par la faucheuse. Le grand éblouissement.
Sous la roue arrière du tracteur, le crâne fait entendre un bref craquement de noix de coco fendue, suivi d'un écœurant gargouillis d'os broyés et de matières en bouillie. Cardinal remet l'engin au neutre, puis saute à terre et, comme fou, la respiration hachée, s'empare des jambes qu'un ultime spasme agite, un interminable frémissement. Il tremble de tous ses membres tandis qu'il s'efforce d'ajuster le pied gauche à la pédale de frein.
Une fois son œuvre accomplie, il s'éloigne de quelques pas, se retourne, presque calmé, les jambes en coton comme après avoir baisé. Et maintenant, il examine d'un œil critique la composition du tableau. Coco ferme les yeux, se masse les paupières, les rouvre, nouveau coup d'œil. Il hoche la tête, du beau travail, respire à fond. Tire un sachet en plastique de sa poche de chemise et un tronçon de paille biseauté et s'envoie une bruyante reniflette à même le contenant.
Puis, il tourne le dos à la scène et contemple un instant le panorama de champs cultivés, de boisés de ferme, de granges peintes dans des tons de rouge qui vont du framboise au sang séché et de silos étincelants, qui s’étend à ses pieds et jusqu’à l’horizon.Derrière lui, le moteur du tracteur continue de tourner. Un dernier coup d’oeil et pas question de traîner dans le coin. Il décide de regagner le chemin de rang à couvert, par le champ voisin, en suivant, invisible de la route, cette rangée d’ormes et d’aubépines, de pommiers sauvages. Il arrive devant la clôture de cèdre, qu’il enjambe, et tandis qu’il s’écartèle pesamment au-dessus des piquets noueux sculptés par les intempéries, de la couleur du granit appalachien, il songe à l’expression clôture de lisses. C’est ainsi qu’on appelle les perchis de cèdre dans la Baie-des-Chaleurs. Langage maritime. Et les bateaux, Coco, il aime bien.
Villebois, nord du 49e parallèle, l’hiver 1951
La cabane est bâtie en rondins non équarris et calfeutrée avec de la sphaigne sèche. Murs gris sombre qui tranchent sur la neige, dans l’air glacé une odeur de fumée de bois, de résineux et de graisse animale rancie. La cheminée, un tuyau de tôle auquel est accroché un plumeau d’une blancheur éthérée et crasseuse.Un panache de caribou est cloué en haut de la porte. Aux murs, des peaux de castors, côté chair exposé, tendues dans des cadres faits de baguettes de bouleau. C’est un des tout premiers souvenirs de Godefroid.
Le lac. La cabane du trappeur.
Ce pays, c’est celui où les chiens quand on les détache deviennent des loups.Celui des barges qui descendirent la rivière avec les meubles des familles des vieilles paroisses entassés sous des bâches au fil du courant. La rivière Turgeon était large comme huit boulevards, entrecoupée de rapides qui secouaient le chaland comme une vieille guimbarde sur un mauvais chemin de terre. Deux cents kilomètres plus loin, elle rejoint la Harricana, dont les eaux roulent vers le nord. On est dans le bassin versant de la baie d’Hudson, là où la dernière poignée de lots a été octroyée, bien au nord de la voie ferrée. Dans ces forêts noires qui épuisent le ciel et sapent l’horizon. Ce pays où seuls les canots de maître des trafiquants de fourrures étaient passés avant eux, et les tribus éparses des nations de la taïga errant à la recherche des dernières cabanes de castors. À des jours de marche et de pagaie encore des collines de Muskuchii et des vastes marécages où nagent les oies bleues. Personne n’irait s’établir plus loin.
Le père de Godefroid avait été journalier, chômeur, manœuvre, il avait rempli un questionnaire du ministère des Terres et Forêts, reçu 800 belles piastres, une tape dans le dos et une terre noire dans les brûlés à perte de vue du nord de l’Abitibi. À quel moment avait-il craqué? Quand était-il devenu cet homme silencieux et renfrogné, un vaincu? C’est sa femme qui avait sauvé le ménage en acceptant le poste d’institutrice, au village: 700 dollars par année, un toit sur la tête, plus vingt cordes de bois de chauffage. Les chiens jappent, ce jour-là. Dans la neige devant la cabane du trappeur, ils aboient comme fous. Pendant que la mère de Godefroid enseigne sa classe de têtes de pioche, son père rend visite au trappeur dans sa cabane au bord du lac, il apporte une bouteille de Seagram’s, il l’écoute montrer ses secrets. Le X de brindilles placé sous le collet pour forcer le lièvre à sauter droit dedans. Quand tu tires sur des perdrix branchées, commence par celle du bas, pour qu’elle n’effraie pas les autres en tombant. Ce pays est celui où les loups courent au bout de la terre et les chiens, les chiens deviennent fous. Le trappeur doit les écarter à coups de pied pour frayer un chemin au père, jusqu’à la porte, le gamin sur les talons.
-= Qu’est-ce qu’ils ont, tes chiens, aujourd’hui, Bill?
Et Bill se contente de ricaner. Ses dents de la couleur du tabac. Il regarde le garçon, ensuite le père, et de nouveau le garçon, puis il dit:
-= Viens. Je vais te montrer quelque chose…
À l’intérieur, des pièges d’acier pendent au bout de leurs chaînes à des clous fichés dans les poutres. Une peau de loutre tannée, lustrée, somptueuse. Une odeur épaisse faite de viande faisandée et d’intestins crevés, de sueur, de laine mouillée, souillée et roussie, de fourrure humide, de fumée de tabac, de thé refroidi, de feu de bois. D’urine aussi et d’autre chose, de plus doux et insidieux, que les hommes sentent tout de suite: la peur. Dehors, les chiens continuent de hurler à la mort. Le trappeur, lentement, se tourne vers le fond de la cabane. Les deux autres, le père et le fils, suivent son regard. En passant la porte, ils ont perçu la présence chaude et obscure, maintenant, ils contemplent l’animal. Sa face de sphinx encadrée de favoris dignes d’un banquier de Dickens, aux oreilles couronnées de touffes de poils hirsutes. Et les yeux, comme deux grands lacs d’ambre qui les avalent. Le lynx est dans l’ombre, assis sur son arrière-train, un collier de chien serré autour d’une patte et relié à la chaîne d’une laisse solidement fixée à une poutre du campe. À l’affût du moindre mouvement, il fixe les trois humains avec une intensité dévorante. Bouche bée, le père se tourne vers le trappeur, qui garde ses yeux plongés dans ceux du gros chat.
-= Veux-tu l’avoir? demande Bill au bout d’un moment.
-= Es-tu fou?
Le coureur de bois allonge le bras, attrape une bouteille de brandy sur une planche servant d’étagère, dévisse le bouchon et avale une rasade. Il tend la bouteille au père, qui préfère passer son tour. Puis, il regarde le gamin. Il lui sourit, un rictus de tous ses chicots.
-= Ça goûte le poulah…, dit-il.
L’enfant détourne les yeux et ne répond rien. Il regarde le lynx.
-= Il veut pas être mon ami, dit Bill en hochant la tête.
-= Qui ça? demande le père.
-= Lui, là, répond Bill. Il montre le lynx.
Puis, nouveau coup de brandy. Les huskies dehors aboient, aboient, ils aboient à mort. Le trappeur boit sec, une nouvelle gorgée. Puis il refile la bouteille au père de Godefroid, qui, cette fois, l’accepte sans un mot.
Ensuite, Bill farfouille dans un coin, un coffre, trappes, couteaux, le bric-à-brac quotidien. Ils le voient maintenant enfiler des gants, de longs gants de protection qui lui vont au coude, taillés dans une étoffe épaisse, comme renforcée, en prenant bien son temps. On dirait des gants de soudeur. Lorsqu’il s’approche du lynx, celui-ci s’écrase au sol et recule sans le quitter des yeux vers le coin le plus éloigné qu’il peut atteindre puis, rendu au bout de la chaîne, il se ramasse sur lui même, les oreilles couchées, les yeux emplis d’une terreur meurtrière. Sans montrer aucune crainte, l’homme vient lentement s’accroupir devant lui. Un sifflement continu, doublé d’un grondement sourd et plaintif de matou s’échappe maintenant de la gueule et des entrailles de l’animal et emplit toute la cabane. Le masque de la bête s’écarquille, déformé par une tension extraordinaire pendant que l’humain et lui s’observent, sans bouger. Puis le premier d’un geste brusque empoigne à deux mains le cou du félin et en serrant le soulève peu à peu de terre. Les grosses pattes rondes labourent toutes griffes dehors les gants qui repoussent le chat, le tiennent à distance, à bout de bras. L’homme sans cesser de serrer et de raffermir sa prise se remet alors debout, on entend un drôle de gargouillis, deux tueurs enlacés, en une danse quasi immobile. Au cours de l’éternité qui suit, le père et l’enfant stupéfaits voient, dans le clair-obscur de la cabane, le loup-cervier passer progressivement de la lutte aux spasmes, ils peuvent suivre l’évolution du trépas sur sa figure énigmatique, la grimace figée, jusqu’à l’ultime trémulation qui secoue l’animal tout entier. Les jambes molles, complètement vidé, le trappeur tombé à genoux repose le fauve et l’allonge sur le plancher en terre battue devant lui. On l’entend haleter tandis qu’il retire ses gants, saisit tout doucement, ensuite, une des énormes pattes, fait jouer les muscles encore brûlants, sous la fourrure, les articulations comme d’une poupée, puis les mains s’égarent un instant dans les longs poils soyeux, en un geste d’une tendresse inouïe.»
}{
Autres livres de Louis Hamelin, un écrivain chevronné.
} La Rage, roman, Québec/Amérique, 1989; Boréal, coll. «Boréal compact», 2010.
} Ces spectres agités, roman, XYZ, 1991; Boréal, coll. «Boréal compact», 2010.
} Cowboy, roman, XYZ, 1992; Boréal, coll. «Boréal compact», 2009.
} Betsi Larousse ou l’ineffable eccéité de la loutre, roman, XYZ, 1994; Boréal, coll.
«Boréal compact», 2009.
} Les Étranges et Édifiantes Aventures d’un oniromane, feuilleton, L’Instant même, 1994.
} Le Soleil des gouffres, roman, Boréal, 1996.
} Le Voyage en pot. Chroniques 1998-1999, Boréal, coll. «Papiers collés», 1999.
} Le Joueur de flûte, roman, Boréal, 2001; coll. «Boréal compact», 2006.
} Sauvages, nouvelles, Boréal, 2006.
} L’Humain isolé, essai, éditions Trois-Pistoles, 2006.
À noter: Le souci de l'environnement. Lisez cette page que vous ne lisez... pas toujours; peut-être même, jamais...
« mise en pages et typographie: les Éditions du boréal
achevé d’imprimer le septembre 2010 sur les presses de transcontinental Gagné à Louiseville (Québec).
Ce livre a été imprimé sur du papier 100% postconsommation, traité sans chlore, certifié ÉcoLogo et fabriqué dans une usine fonctionnant au biogaz.»
Résolution de l'année 2011
Je lirai, tu liras, il ou elle lira, nous lirons, vous lirez, ils liront
des livres durables, des livres à relire
Bonne lecture!
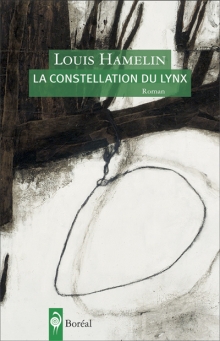 Pour eux aussi l’histoire n’était que contes pareils à
Pour eux aussi l’histoire n’était que contes pareils à 










